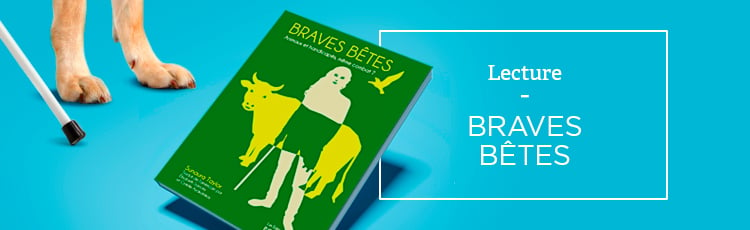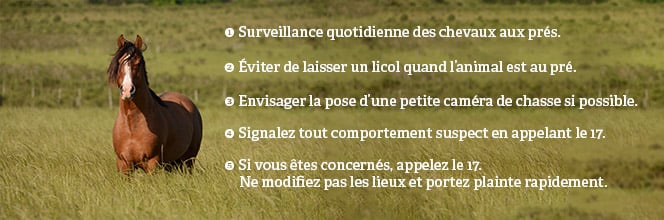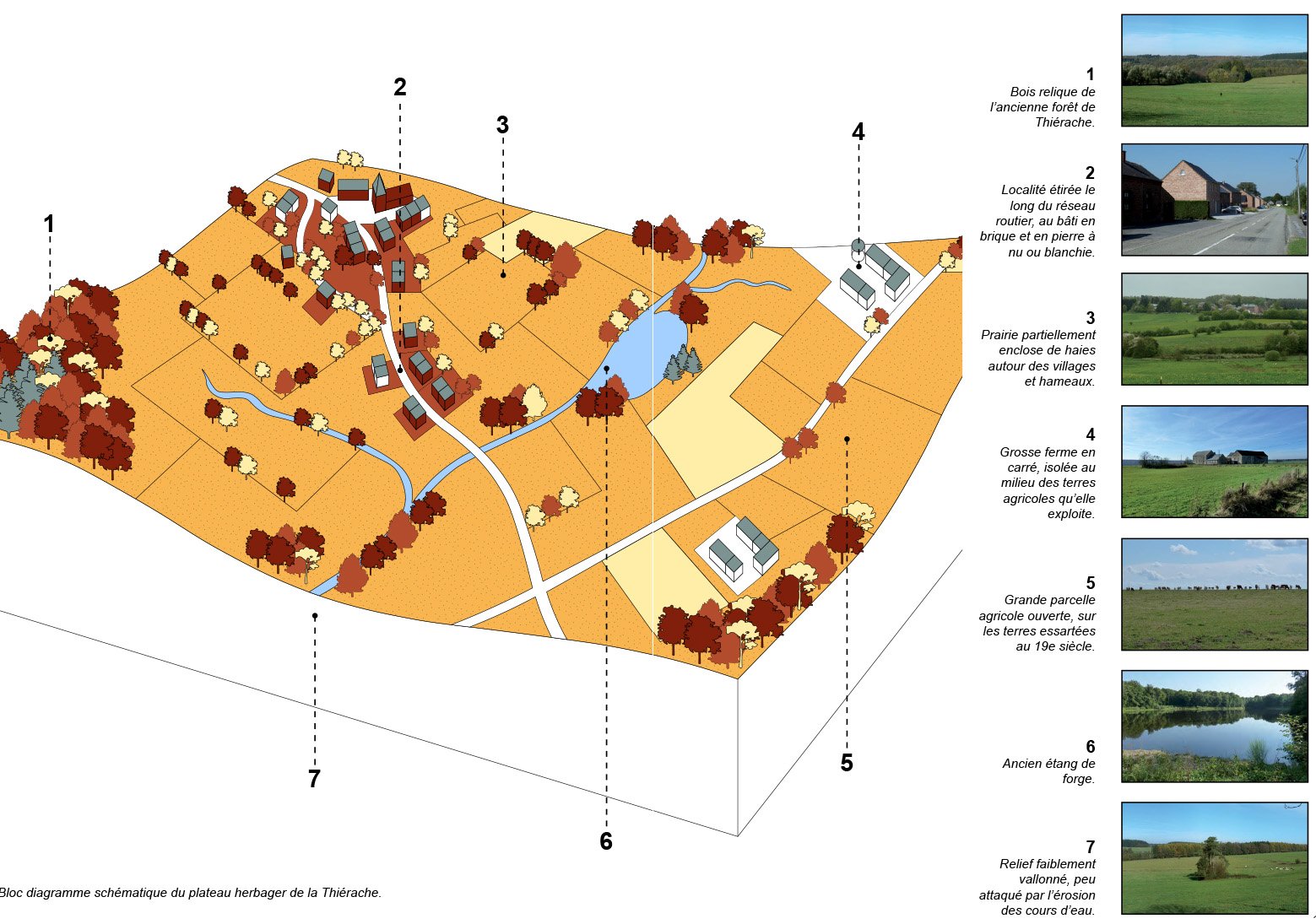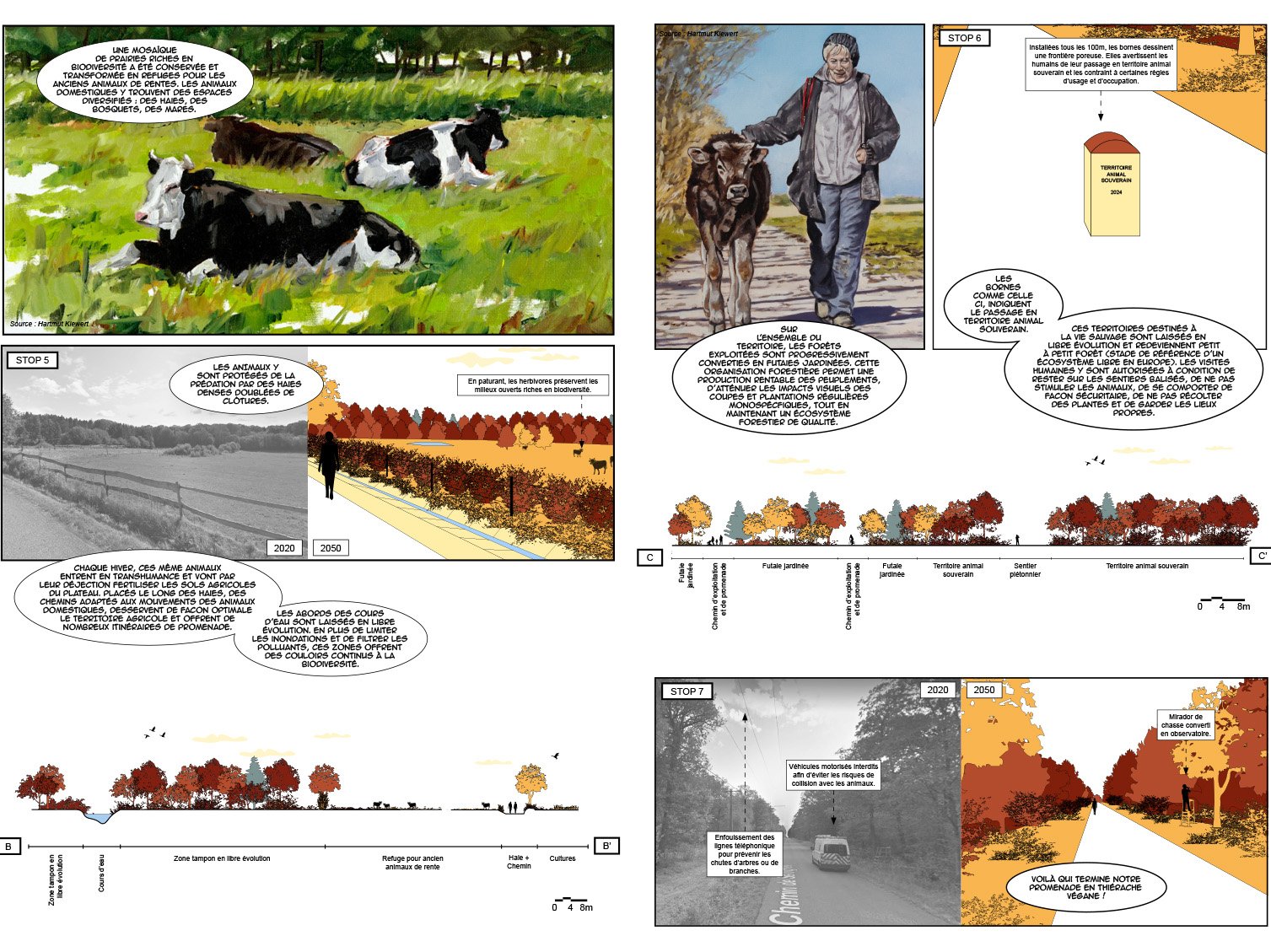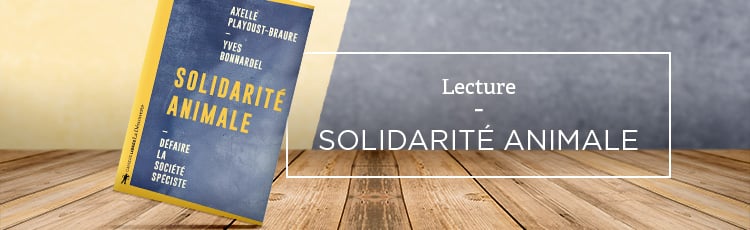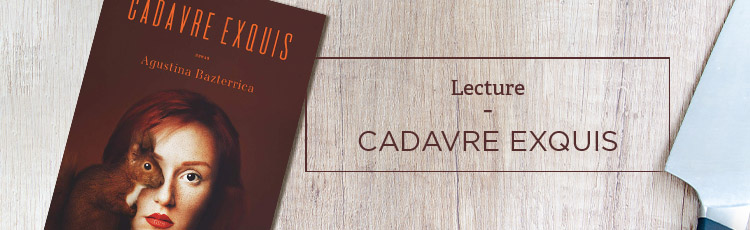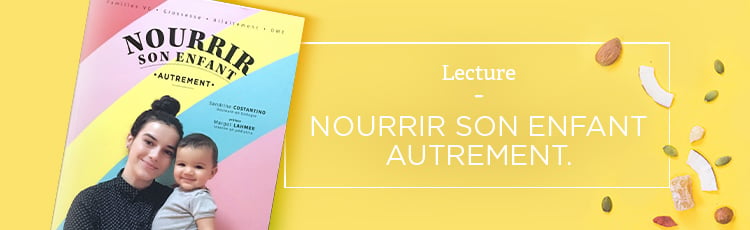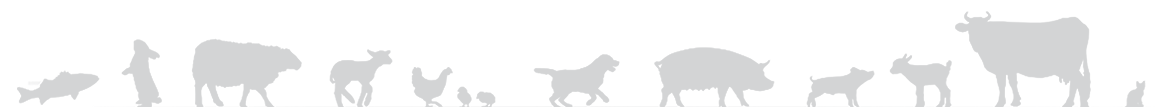L214 et la viande in vitro : une fake news tenace
- Article du Lundi 16 novembre 2020

Le samedi 14 novembre 2020, l’émission Secrets d’info de France Inter diffusait une émission réalisée par la cellule investigation de Radio France, intitulée « Derrière L214, l’ombre de la viande in vitro ». Le même jour, France Info relayait cette émission dans une courte dépêche : « Des dizaines de start-up travaillent à la création de viande cellulaire. Pour préparer l’opinion, elles investissent dans des fondations qui aident des associations de défense des animaux, dont L214. »
Comment une théorie fumeuse née dans les milieux agricoles s’est-elle retrouvée présentée comme une vérité par des médias ? Itinéraire d’une fake news particulièrement tenace.
Présentée comme une révélation découlant d’un long travail d’enquête de Radio France, cette hypothèse, qui circule depuis quelques années dans les milieux agricoles, a surtout été développée en 2019 par Jocelyne Porcher dans son livre Cause animale, cause du capital. Elle fut ensuite reprise par Paul Ariès, Gilles Luneau et d'autres personnes ouvertement hostiles à L214, beaucoup se prévalant d’avoir enquêté personnellement alors qu’ils ne font que reprendre telle quelle une thèse née, en réalité, sur la page Facebook Anti-vegan l’année précédente.
Ainsi, sous couvert de philanthropie, des industriels américains de la viande cellulaire financeraient des associations de défense des animaux en France pour accélérer la disparition de l’élevage français, avec la complicité des GAFAM. Qu’en est-il des affirmations que contient cette thèse ?
Les GAFAM financent-ils L214 ?
Non. Le raccourci invoqué par les tenants d’une conspiration est que l’Open Philanthropy, organisation donatrice de L214, est née en 2014 d’un partenariat entre GiveWell – une ONG visant à identifier et promouvoir les associations les plus efficaces pour lutter contre l’extrême pauvreté et améliorer la santé des habitants des pays en développement – et une fondation philanthropique – Good Ventures – créée par Dustin Moskovitz, l'un des cofondateurs de Facebook, qui a quitté l’entreprise en 2008. L’OP est devenue une entité indépendante en juin 2017.
Qu’est-ce que l’Open Philanthropy ?
L’action de l’Open Philanthropy est principalement dirigée vers la justice sociale et l’aide aux populations en difficulté : recherche ou aide médicale directe (lutte contre le paludisme, recherches sur les épidémies comme récemment sur la Covid-19), aide aux réfugiés, lutte contre les discriminations ou soutien aux organisations qui œuvrent pour une réforme de la justice américaine, etc.
Comme le « Open » de son nom l’indique, l’OP est attachée à la transparence de son fonctionnement et fournit par exemple la liste complète des financements qu’elle a accordés, et de leurs bénéficiaires.
L’Open Philanthropy, donatrice de l’association L214, est-elle financée par des entreprises de la viande cellulaire ?
Non. Les fondateurs et principaux financeurs de l’Open Philanthropy sont Cari Tuna, journaliste, et Dustin Moskovitz, cofondateur d’Asana (logiciel de gestion de projet) et de Facebook, qu’il a quitté en 2008.
Parmi les dons de l’Open Philanthropy à des organisations œuvrant pour la paix dans le monde ou à des mouvements sociaux progressistes (racisme, maltraitance animale, droits des minorités...), l’investissement réalisé en 2016 dans Impossible Foods – une entreprise qui développe des alternatives végétales à la viande (pas de la viande de culture) – est sans doute à l’origine de cette confusion.
L’association L214 a-t-elle reçu un don de l’Open Philanthropy en 2017 ?
Oui. Fin 2017, l’Open Philanthropy (OP) a soutenu L214 par un don de 1,14 million d’euros pour 2 ans (finalement utilisé sur 3 ans). Ce soutien est renouvelé pour les 2 prochaines années à hauteur de 1,4 million d’euros. Ces fonds alloués à L214 sont dédiés à la poursuite de son travail d’enquête et d’information concernant les animaux utilisés à des fins alimentaires, ainsi qu'à ses actions pour faire reculer les pires pratiques d’élevage et d’abattage des poulets.
D’aucuns ont cru avoir découvert un financement caché en parcourant… les comptes annuels de l’association, publiés chaque année au Journal officiel, et disponibles sur son site internet ! Une transparence dont des géants de l’industrie de la viande comme Bigard ou Lactalis, par exemple, pourraient s’inspirer.
À noter : les actions de L214 ne dépendent pas de ce don mais de la générosité de plus de 48 000 membres – que nous remercions chaleureusement –, dont les dons représentent 90 % du montant total des dons faits à l'association.
Des dizaines de start-up travaillent-elles à la création de viande de synthèse ?
Oui. Environ une trentaine de start-up, aux États-Unis mais aussi en Europe et en France, en Asie ou en Israël, développent aujourd’hui des steaks hachés, des boulettes, des nuggets de poulet, des saucisses, du foie gras ou encore des filets de poisson conçus à partir de cellules animales.
Qui cherche à développer la viande de laboratoire ?
Initié par des chercheurs comme le néerlandais Mark Post, le développement de produits animaux de culture est aujourd’hui le fait de nombreux acteurs. Il s’agit principalement de laboratoires privés, soutenus par des fonds d’investissement, par des géants mondiaux de l’industrie de la viande comme Cargill ou Tyson Foods aux États-Unis, ou Bell Food Group, gros producteur de viande en Suisse, ou par des milliardaires comme Bill Gates ou Richard Branson. En France, Grimaud, spécialiste en génétique animale volailles & lapins, a lancé l’entreprise Vital Meat. Certains y voient un marché juteux, d’autres y voient des promesses pour moins d’animaux tués, moins d’impacts sur l’environnement. Tous s’accordent sur le fait que cette viande de culture pourrait être une alternative à la viande industrielle.
Dénoncer le sort des animaux = promouvoir la viande de culture ?
Ce raisonnement complotiste est grotesque. Il va de soi que nous n’entendons pas nous laisser enfermer dans cette équation fallacieuse, et encore moins abandonner les animaux à leur sort. Le travail de L214 a mené, entre autres, à des fermetures d'élevages vétustes, de couvoirs ou de chaînes d'abattage en infraction, à l'engagement de nombreuses entreprises à faire reculer les pires pratiques d’élevage intensif, à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les abattoirs. Si des opinions divergentes peuvent tout à fait se concevoir sur la question animale, il est néanmoins inacceptable qu'elles reposent sur de fausses informations et des tentatives de discréditer le travail des associations.
En conclusion, aucun élément n’accrédite l’existence d’une stratégie – secrète ou non – des entreprises développant de la viande de culture qui viserait à financer l’action des associations de défense des animaux dans le but de préparer l’opinion à cette technologie. L214 invite chacun à examiner les faits avec honnêteté, et à se recentrer sur la lutte contre les cruautés faites aux animaux.
Pour aller plus loin :
Altruisme Efficace : Ce qu’est Open Philanthropy Project (et ce qu’il n’est pas)
Check News / Libération : L’association L214 est-elle financée par une fondation américaine ?
Répartition et utilisation des dons faits à L214 : https://www.l214.com/nous-rejoindre/transparence-financiere
Qu’est-ce que la viande cellulaire : https://agriculturecellulaire.fr/agriculture-cellulaire
Les Échos : Cargill investit dans la viande artificielle
Réussir, Les Marchés : Viande in vitro : Tyson Foods investit dans Future Meat Technologies
Ouest-France : Agriculture. Une société angevine se prépare à la viande in vitro
PRNewsWire : Mosa Meat lève 7,5 millions d'euros pour commercialiser la viande cultivée