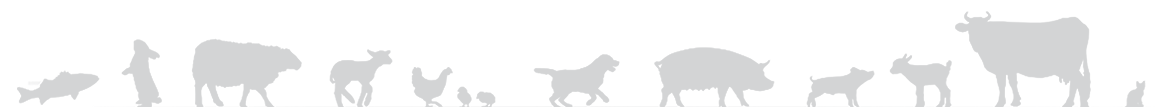Deux kilos deux : entretien avec Gil Bartholeyns
- Article du Jeudi 4 juin 2020

Deux kilos deux, c’est le poids moyen d’un poulet lors de son abattage. C’est aussi le titre d’un roman dans lequel Gil Bartholeyns raconte l’histoire de Sully, un jeune inspecteur vétérinaire débarqué dans un village isolé de Belgique pour y mener un contrôle dans un élevage de poulets. Alors que la neige immobilise le village, Sully mène l’enquête. Rencontre avec un écrivain engagé pour les animaux !
Pourquoi avoir voulu écrire sur les poulets ?
La poule et le coq (car le poulet c’est un nom de consommation) sont des oiseaux des forêts tropicales d’Asie. Qui le sait encore ? La déconnexion est totale. C’est ce qu’évoque le titre du roman. Deux kilos deux, c’est un poids d’abattage moyen, mais il varie sans cesse selon qu’on « fasse » du poulet à rôtir ou des filets, du conventionnel ou du bio. L’important c’est que c’est une quantité. Des êtres vivants dont le nombre est calculé en kilos par mètre carré. C’est aussi l’animal terrestre le plus mangé dans le monde. On se trouve à mille lieues de la beauté de ces oiseaux mordorés des sous-bois indiens. Et selon la Déclaration de Cambridge, les oiseaux présentent un cas d’évolution parallèle de la conscience.
Mais ce qui compte pour moi, c’est l’individu, son corps, sa vie. Dans les élevages vous avez affaire à des océans de volailles. Aucun développement social et émotionnel normal n’est possible dans de tels lieux. Nous, les humains, nous pouvons toujours nous évader, rêver... Les poulets, eux, sont réduits à leur corps. Et s’ils sont essentiellement leur corps dans l’expérience qu’ils font de cet univers, c’est à partir de lui que se mesure la qualité d’une existence. Or, dans la législation et sur le terrain, j’ai découvert une maltraitance institutionnelle. Même si l’éleveur respecte scrupuleusement les normes dites du bien-être, on est stupéfait devant ces êtres qui sont anéantis après quelques semaines, alors qu’ils peuvent vivre dix ans. C’est ce qui se passe sur l’exploitation de Frederik Voegele dans le roman : légalement, elle est irréprochable, et pourtant les poulets sont dans une détresse absolue.

Comment avez-vous préparé l’écriture de votre livre ?
Au départ je ne pensais pas écrire sur l’élevage. J’avais un cadre, les Hautes Fagnes belges en pleine tempête de neige, et une histoire d’amour. Mais en cherchant pourquoi Sully, le personnage principal, arrive là, je me suis intéressé aux inspecteurs vétérinaires. J’ai commencé à enquêter et c’est devenu une matière romanesque incroyable. On parle de roman initiatique. Pour moi, l’épreuve a été le terrain et l’écriture. J’ai voulu partager ce que j’ai ressenti et emmener le lecteur là où commence notre délire civilisationnel. Qui est un délire technocratique et biotique. Un délire systémique auquel l’événement planétaire du COVID-19 est directement lié, parce que nous ne savons plus vivre avec les animaux. Il est trop facile de penser que le mal vient de la consommation d’animaux sauvages vendus dans des marchés insalubres. La majorité des zoonoses, de la grippe espagnole de 1918 aux virus émergents actuels, sont issues de l’élevage, pour ne rien dire des bactéries et de l’antibiorésistance qui représentent une menace sans précédent. Le roman est sans équivoque, mais je n’y prends pas moi-même position. C’est une écriture sans jugement parce que le problème est justement systémique. Si on vise des gens ou des circonstances particulières, on rate l’essentiel.
Quand je suis allé voir les éleveurs, aucun d’eux ne m’a parlé de souffrance ou d’impuissance. Ils m’ont assommé de règles, d’obligations, de calculs. Je venais pour parler de leur métier et du bien-être, et ils me parlaient de mises aux normes, d’Europe, de « meilleures techniques disponibles », de concurrence. Je me suis rendu compte que, pendant tout ce temps, les valeurs étaient évacuées, le libre arbitre aboli. Ils étaient dedans jour et nuit. Je me suis dit : c’est ça un système d’exploitation. Je ne pouvais pas rentrer chez moi et écrire le même livre, centré sur un personnage qui cherche à résoudre une enquête sans y laisser trop de plumes. J’ai essayé de mettre en scène cette aliénation à travers des intimités fracturées, de faire voir la complexité de cet univers qui est aussi un univers d’ingénieurs qui pensent en savants pragmatiques, avec des éléments de langage.

Avez-vous rencontré des difficultés pour mener votre travail ?
L’univers de l’élevage est réputé fermé mais j’ai été bien accueilli partout. Surtout par les groupes d’influence. J’étais un « historien », un « anthropologue ». Je disais que je travaillais sur l’élevage, sur le bien-être animal et que je voulais comprendre. Ce qui a le plus compté, c’est la chaîne d’approche : un tel, responsable de ceci, vous introduit à tel autre, qui vous recommande à une autre personne, et ainsi de suite. C’est de cette façon que je suis passé du ministère aux institutions de promotion, puis aux éleveurs, aux fournisseurs, aux ouvriers. Il est d’autant plus important de le dire que la France a commencé à criminaliser la prise d’images et leur diffusion, comme certains États américains.
Du côté des associations de défense, je voulais rencontrer des responsables de refuges d’animaux de ferme parce qu’ils travaillent avec les autorités, ils sont à la charnière. Là j’ai trouvé des personnes formidables. Ailleurs, dans certaines institutions, la parole était contrôlée. Vous vous retrouvez à parler à quelqu’un et, derrière, quelqu’un d’autre monte la garde. Ou bien on souhaite recevoir vos questions à l’avance. Ou bien on ne veut pas vous recevoir directement pour des raisons de protection des méthodes de travail, et là je parle des inspecteurs vétérinaires. Mais tout s’est toujours déroulé avec une ouverture surprenante, une envie de m’expliquer, de me montrer. On me confiait des rapports. Je revenais abasourdi.
Qui est votre personnage préféré dans ce roman ?
C’est Louis. Louis a cinq ans. À trois ans et demi, il sait qu’il mange de la viande mais il ne sait pas que ce sont des animaux. Il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup d’indices dans un bâtonnet de poisson ou une saucisse. C’est sa mère, Léa, qui le lui a dit. Alors Louis pense qu’on les mange une fois qu’ils sont morts. Mais sa mère lui a dit qu’on les tuait pour les manger. Alors Louis s’est mis à détester les chasseurs. Il n’a pas l’idée de l’élevage, et sa mère n’a pas le courage de lui dire qu’on les fait grandir dans des lieux spéciaux... Louis a décidé d’arrêter d’en manger. Il ne peut pas caresser et tuer en même temps. Il ne fait pas de différence entre un chat et un lapin. Il ne veut plus manger ceux qui sont pour lui une source intarissable de joie et de curiosité. Il finit même par dire « en plus, on est des animaux, c’est comme si on se tuait nous ». Il tient ce raisonnement que Sully aurait voulu avoir beaucoup plus tôt dans sa vie, alors même qu’il est médecin vétérinaire. Combien d’années passées à vivre contre ses propres valeurs, se dit-il, alors qu’il soignait les oiseaux du jardin et sauvait les abeilles à la surface des piscines ? « Quel sortilège avait-on jeté sur le monde ? Pourquoi était-il si difficile à l’humanité de se définir selon un bien qui transcende ses frontières ? »

Les animaux d’élevage ont une forte présence dans votre livre, ils sont des personnages à part entière. Qu’avez-vous souhaité faire transparaître dans ces descriptions ?
Au moment où j’écrivais, on parlait beaucoup des abattoirs et du broyage des poussins. Je ne voulais pas aller dans cette direction. C’est l’existence des animaux qui m’intéressait, ce moment où les hommes et les bêtes partagent leur vie, et ce moment touche beaucoup d’espèces. Il y a tout un peuple dans le livre. Le rat, le chat, le renard, la chouette, la fourmi, le lynx, les dindes... et il y a ce veau qui naît grâce à ces gestes qui donnent la vie. Je voulais qu’à un moment donné les personnages soient réunis par quelque chose de plus grand qu’eux. Est-ce que ce veau devait naître ? Oui. Est-ce qu’il devait exister ? Non. Tous ces animaux n’appartiennent pas, malgré tout, au même monde, les sauvages, les domestiques, les animaux d’élevage. Leurs régimes juridiques font que les uns sont protégés, les autres abattus. Beaucoup d’entre eux sont des chimères. Ils ne peuvent pas mettre bas naturellement. Ils peuvent à peine atteindre l’âge adulte sans crise cardiaque ou sans problème de locomotion. Ils ne sont pas faits pour vivre au-delà du temps prévu. Ce mode d’existence donne le vertige.
Quel rôle peut jouer la littérature dans la défense des animaux aujourd’hui ?
C’est une grande question. On sait le choc qu’a produit un livre comme La Jungle d’Upton Sinclair. Mais ce n’est pas un roman. Les romans qui abordent les animaux d’élevage sont souvent écrits dans le bouleversement. Ce ne sont pas des manifestes. Je pense à La Vache de Beat Sterchi. Alors quels pouvoirs possède la littérature ? La force de la littérature est peut-être dans sa ruse. On entre dans une histoire, on apprend des choses sans l’avoir voulu, on éprouve des émotions envers des personnages qui n’ont pas nécessairement le beau rôle. On est toujours dans la singularité. Le roman trompe les généralités, il crée des intériorités. Dans Deux kilos deux, chacun porte sa façon de voir et on est amené à la comprendre à partir de ce qui lui arrive. Et puis il y a ce qui arrive aux animaux. Écrire « X milliards d’animaux ont été abattus », cela ne dit rien. Avec le roman, on peut restituer et ressentir le gouffre, l’expérience que cela représente.