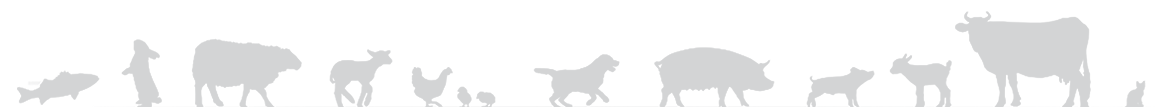Le corps des autres
- Article du Mardi 10 octobre 2017

J’ai toujours été frappée par la façon dont la société s’approprie le corps des femmes. Et régulièrement, face à des réflexions machistes, sexistes, et à l’oppression en général, je me sens reléguée au rang d’animal.
Non pas que je méprise les animaux, bien au contraire ; c’est plutôt que la société m’écrase un peu comme eux, même si leur oppression est évidemment infiniment plus brutale. N’empêche, je me sens comme un paquet de viande ou une bête de foire quand des hommes me balancent leurs remarques grasses et crues - ce qui m’est arrivé un paquet de fois -, le plus souvent simplement parce que je les croise dans la rue. Tous ces regards, ces gestes et ces paroles qui se focalisent sur mon corps sont une négation de ma personnalité. Mains baladeuses, paroles obscènes, blagues douteuses et remarques déplacées, le harcèlement est clair : mon corps de femme leur appartient. Publiquement, collectivement. Je suis une marchandise dont on évalue la valeur. Je me sens comme une bête avec laquelle les plus forts peuvent, si l’humeur leur en dit, s’amuser impunément.

Photo : Sanctuario Igualdad
Je suis pourtant tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Mais je suis une femme, une marchandise. Et je suis une marchandise aux yeux bleus, ce qui m’a valu un nombre incalculables de remarques masculines qui pourraient toutes se résumer à : “Vous avez des yeux magnifiques ! Tu baises ?”
Il y a tant de façons de s’approprier le corps des autres. On peut par exemple engraisser celui des animaux jusqu’à les déformer complètement, comme on le fait pour des centaines de millions de poulets de chair, de cochons ou encore d’oiseaux que l’on gave pour produire du foie gras. En Mauritanie, fut un temps pas si éloigné où on gavait aussi les fillettes, simplement parce que l’obésité était perçu comme un canon de beauté féminine. Aujourd’hui, 22 % des Mauritaniennes souffrent encore des effets du gavage, même s’il ne perdure plus que dans quelques recoins isolés du pays.
À travers le monde aujourd’hui, les femmes souffrent plutôt du diktat de la minceur. Il ne s’agit pas de nier que trop de kilos ne sont pas bénéfiques à la santé. Mais le problème dont il est question ici est purement esthétique. Et pour beaucoup de femmes, c’est une véritable obsession qui s’exprime par la peur de grossir et l’envie de perdre du poids (même lorsque ce n’est pas nécessaire). Car le discours dominant est clair : une femme avec trop de kilos par rapport à la norme ne peut tout simplement pas plaire, donc être heureuse. C’est triste et inquiétant de voir à quel point nous, les femmes, avons intériorisé ce discours normatif. Je ne connais aucune femme, quelle que soit sa corpulence, qui échappe à la grossophobie. Heureusement, quelques unes assument avec joie leur corps non réglementaire, et ça fait du bien.
L’appropriation de son corps par d’autres ne concerne évidemment pas seulement les animaux et les femmes, mais aussi les personnes qui échappent à la norme ou les plus vulnérables, comme les malades mentaux, les enfants ou les homosexuels. Il y a quelques années, j’ai lu un livre qui m’a profondément bouleversée. L’auteur, Ji Ro, raconte le viol dont il a été victime. Comment, une nuit dans un parc, il a été brutalement agressé par trois hommes, parce qu’il avait les cheveux roses, des bagues aux doigts, les ongles vernis, parce qu’il était petit et fluet, parce qu’il était homo. Son livre s’appelle Comme un chien, et quand on sait que Ji Ro est antispéciste, le titre prend un tout autre sens. Il m’a d’autant plus touchée que Ji Ro était un ami. Si je l’ai vu quelques jours après son viol et qu’il en a parlé, ce n’est qu’à la lecture du livre que j’ai pleinement saisi l’horreur de ce qu’il avait vécu.
Mais combien de victimes ne peuvent même pas exprimer ce qu’elles endurent ?
Être une femme, un homo, une “minorité”, un animal, une proie. Comme cette prostituée que j’ai rencontrée lorsque je travaillais à Cabiria et qui a réussi par miracle à échapper à un client qui l’agressait, puis a attendu toute la nuit, nue, terrorisée, cachée dans des buissons, jusqu’à ce que des éboueurs la secourent au petit matin.
Être au mauvais moment au mauvais endroit. Mais les bons endroits sont finalement assez rares, surtout pour les animaux, et encore plus pour les animaux destinés à être mangés. Ces lieux ne sont qu’une poignée, et ce sont essentiellement des refuges qui, véritables havres de paix, leur viennent en aide courageusement.
Heureusement, en prenant de l’âge j’ai bien senti que j’étais moins appétissante, donc les hommes me harcèlent nettement moins. Un peu comme si j’étais périmée. Si j’étais un animal non humain, on m’aurait déjà abattue depuis longtemps. Au cours de ma vie, on m’aurait aussi mutilée, inséminée, enfermée, engraissée, bourrée de médicaments, déplacée, manipulée.
Il faut donc reconnaître que j’ai finalement énormément de chance. Déjà, celui d’être née du bon côté des espèces puisque je fais partie de celle qu’on ne mange pas, ni ne tue pour se vêtir ou tester divers produits. Du moins, pas en France actuellement, puisque l’Histoire nous a montré que parfois des humains peuvent traiter d’autres humains comme nous nous permettons encore de traiter les autres animaux. Et, chanceuse parmi les humains, je suis née dans un pays riche et en paix, j’ai bénéficié d’une instruction, je n’ai jamais souffert de la faim, je n’ai même jamais été obligée de dormir dans la rue. Au regard de millions d’autres humains (je ne parle même pas des animaux), c’est indéniable : je suis une super privilégiée.
Enfin, j’ai aussi la chance incroyable de pouvoir utiliser ces privilèges pour aider celles et ceux qui n’ont pas ma chance, qu’ils soient humains ou animaux. J’ai par exemple la chance de pouvoir choisir de ne pas manger ces derniers, de pouvoir parler pour celles et ceux qui ne le peuvent pas. Tous ceux et celles à qui on fait si cruellement payer leur différence.
Car comme l’a écrit Jeremy Bentham dès le XVIIIe siècle, “la question n’est pas : peuvent-ils raisonner ? Ni : peuvent-ils parler ? Mais : peuvent-ils souffrir ?”
Clèm