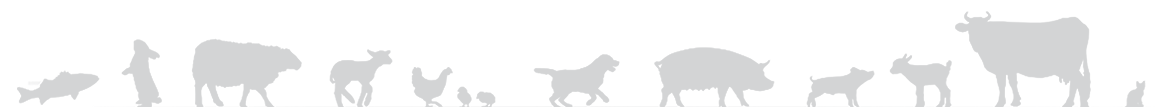Confessions d’une employée d’abattoir
- Article du Mardi 19 mai 2020

Chaque mois, environ 100 millions d’animaux sont tués pour leur viande au Royaume-Uni [ndlt : soit à peu près autant qu’en France], mais on parle très peu des gens chargés de leur mise à mort. Voici donc le témoignage d’une ancienne employée d’abattoir : elle y décrit son travail et l’effet qu’il a eu sur sa santé mentale.
Avertissement : ce récit comporte des passages difficiles.
Quand j’étais enfant, je rêvais de devenir vétérinaire. Je m’imaginais en train de jouer avec des chiots espiègles, de rassurer des chatons apeurés et, comme j’ai grandi à la campagne, d’examiner les animaux des fermes du coin s’ils étaient malades.
La vie dont je rêvais était assez idyllique, mais ce n’est pas de cette façon que les choses ont tourné. Au lieu de ça, je me suis retrouvée à travailler dans un abattoir.
J’y suis restée pendant six ans et, bien loin d’aider de pauvres vaches à se sentir mieux, je devais m’assurer qu’environ 250 d’entre elles étaient tuées chaque jour.
Qu’ils mangent de la viande ou non, la plupart des gens au Royaume-Uni n’ont jamais vu l’intérieur d’un abattoir, et pour une bonne raison : ce sont des lieux sales, immondes. Il y a des excréments sur le sol, on y voit et on y respire l’odeur des boyaux, et les murs sont couverts de sang.
Et cette odeur… Elle vous tombe dessus comme un tas de briques, puis emplit l’air autour de vous. L’odeur des animaux mourants vous entoure comme un brouillard.
Pourquoi est-ce que quelqu’un choisirait de visiter un endroit pareil, et à plus forte raison d’y travailler ?
Dans mon cas, c’est parce que j’avais déjà travaillé une vingtaine d’années pour l’industrie agroalimentaire, dans des usines de plats préparés et autres. Alors quand on m’a proposé un poste de responsable du contrôle qualité, au contact direct des ouvriers de l’abattoir, ça m’a paru être une transition professionnelle assez banale. J’avais la quarantaine à l’époque.
Mon premier jour, on m’a fait faire le tour des lieux, on m’a expliqué comment les choses fonctionnaient et, surtout, on m’a demandé à plusieurs reprises avec insistance si je tenais le coup. On m’a expliqué qu’il était assez habituel que des gens s’évanouissent pendant ces visites et que la sécurité des visiteurs et des nouveaux venus était très importante. Je tenais le coup, je crois. J’avais la nausée, mais j’ai pensé que j’allais m’habituer.
Très vite, pourtant, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de prétendre que c’était un travail comme les autres. Je suis sûre que chaque abattoir est différent, mais le mien était un endroit brutal et dangereux. Je ne compte plus les fois où, bien qu’ils aient suivi les procédures d’étourdissement, des ouvriers ont reçu des coups d’une énorme vache en train de convulser alors qu’ils la suspendaient sur la chaîne d’abattage. De même, les vaches qui arrivaient étaient effrayées et paniquaient, ce qui était assez terrifiant pour chacun d’entre nous également. Si vous en avez déjà approché une, vous savez que ce sont des animaux franchement imposants.
Personnellement, je n’ai pas subi de blessure physique, mais c’est mon mental qui en a pris un coup.

Tandis que les jours s’écoulaient, les uns après les autres, dans cette grande boîte sans fenêtre, le poids sur ma poitrine ne cessait de grossir et c’était comme si une nappe de brouillard gris était tombée sur moi. La nuit, mon esprit me tourmentait avec des cauchemars, rejouant les horreurs dont j’avais été témoin dans la journée.
Une compétence que l’on acquiert lorsqu’on travaille en abattoir, c’est la dissociation. On apprend à devenir indifférent à la mort et à la souffrance. Au lieu de penser aux vaches comme à des êtres entiers, on les compartimente en parties du corps comestibles et commercialisables. Ça ne sert pas qu’à faciliter le travail : c’est indispensable pour survivre.
Il y a pourtant des choses qui ont le pouvoir de faire voler l’indifférence en éclats. Pour moi, c’était les têtes.
À la fin de la ligne d’abattage, il y avait une énorme benne remplie avec des centaines de têtes de vache. Chacune d’entre elles avait été dépecée, toute la peau qui pouvait être vendue avait été retirée. Mais il y avait une chose qui restait : leurs globes oculaires.
À chaque fois que je passais devant cette benne, j’avais immanquablement l’impression que des centaines de paires d’yeux me regardaient. Certaines étaient accusatrices, sachant que j’avais participé à leurs morts. D’autres semblaient suppliantes, comme si, d’une manière ou d’une autre, je pouvais remonter le temps et les sauver. C’était à la fois répugnant, terrifiant et déchirant. Ça me faisait me sentir coupable. La première fois que j’ai vu ces têtes, j’ai eu toutes les peines du monde à me retenir de vomir.
Je sais que ce genre de choses perturbait aussi les autres employés. Je n’oublierai jamais le jour – je travaillais à l’abattoir depuis quelques mois – où l’un des gars a entaillé le corps d’une vache fraîchement tuée pour l’étriper et que le fœtus d’un veau en est sorti. Elle était pleine. Il a immédiatement commencé à crier et à lever les bras au ciel.
Je l’ai emmené dans une salle de réunion pour le calmer, et tout ce qu’il arrivait à dire, c’était « C’est pas normal, c’est pas normal » en boucle. Ces hommes-là étaient des durs qui montraient rarement leurs émotions. Mais je pouvais voir des larmes perler au coin de ses yeux.
Il y avait encore pire que les vaches gestantes, pourtant : les jeunes veaux que nous devions parfois tuer.

Au pic des crises de la maladie de la vache folle et de la tuberculose bovine dans les années 1990, de nombreux groupes d’animaux ont dû être abattus. J’ai travaillé à l’abattoir après 2010, donc bien après la crise de la vache folle, mais si un animal était testé positif pour la tuberculose bovine, on faisait encore abattre des familles entières : des taureaux, des génisses et des veaux. Je me souviens d’un jour en particulier, j’étais là depuis un an environ, quand on a dû abattre cinq veaux d’un coup.
On essayait de les maintenir dans les enclos, mais ils étaient si petits et émaciés qu’ils pouvaient facilement s’échapper et trottiner alentour, leurs pattes de nouveau-nés tremblant légèrement. Ils nous reniflaient, comme des chiots, parce qu’ils étaient jeunes et curieux. Quelques gars et moi, on les a caressés et ils ont tété nos doigts.
Quand est venu le moment de les tuer, ça a été dur, à la fois émotionnellement et physiquement. Les abattoirs sont pensés pour tuer de très gros animaux, alors les box d’étourdissement étaient à la bonne taille pour contenir une vache d’environ une tonne. Quand on a mis le premier veau dedans, il n’arrivait qu’à un quart de la hauteur du box, à peine. On a mis les cinq veaux à la fois dedans et on les a tués.
Après coup, en regardant les animaux morts sur le sol, les ouvriers étaient clairement bouleversés.
Je les ai rarement vus aussi vulnérables. À l’abattoir, on avait tendance à refouler ses émotions. Personne ne parlait de ses sentiments, on avait l’impression insurmontable qu’on n’avait pas le droit de montrer la moindre faiblesse. Et puis il y avait plein d’employés qui n’auraient pas pu parler de ce qu’ils ressentaient avec nous, même s’ils avaient voulu. Nombre d’entre eux étaient des travailleurs migrants, principalement d’Europe de l’Est, dont le niveau d’anglais n’était pas assez bon pour demander de l’aide s’ils en avaient besoin.
Beaucoup des hommes avec qui je travaillais avaient aussi des boulots au noir ailleurs. Ils finissaient leurs 10 ou 11 heures à l’abattoir avant de se rendre à un autre job. L’épuisement laissait des traces. Certains ont développé des problèmes de boisson, venant souvent travailler en sentant fortement l’alcool. D’autres sont devenus accros aux boissons énergétiques, et certains ont eu une crise cardiaque. Ces boissons ont ensuite été retirées des distributeurs de l’abattoir, mais les gens continuaient d’en apporter de chez eux et de les boire discrètement dans leur voiture.
Un lien a été établi entre le travail en abattoir et de multiples problèmes de santé mentale. Un chercheur utilise le terme Perpetrator-Induced Traumatic Syndrome (« syndrome traumatique causé par l’auteur ») pour désigner les symptômes de stress post-traumatique dont souffrent les ouvriers d’abattoir. J’ai personnellement souffert de dépression, un état aggravé par les longues heures de travail acharné et par le fait de côtoyer la mort. Au bout d’un moment, j’ai commencé à avoir des pensées suicidaires.
On ne sait pas exactement si c’est le travail en abattoir qui cause ces problèmes ou s’il attire des personnes avec des problèmes préexistants. Mais dans tous les cas, c’est un travail où l’on est incroyablement isolé et où il est difficile de demander de l’aide. Quand je disais aux gens ce que je faisais, j’étais confrontée soit à un dégoût absolu, soit à un mélange de fascination, de curiosité et de blagues. Dans tous les cas, je ne pouvais jamais me confier au sujet des effets que ce travail avait sur moi. Au lieu de ça, j’ai parfois participé aux plaisanteries avec des anecdotes sanglantes sur le dépeçage d’une vache ou le traitement de ses tripes. Mais le plus souvent, je gardais le silence.

Alors que j’étais à l’abattoir depuis quelques années déjà, un collègue a commencé à faire des allusions désinvoltes au fait qu’il « ne serait plus là dans six mois ». Tout le monde en riait. C’était un peu un blagueur, alors les autres pensaient qu’il se foutait d’eux, insinuant qu’il aurait un nouveau boulot ou quelque chose comme ça. Mais ça m’a mise vraiment mal à l’aise. Je l’ai entraîné dans une pièce voisine et lui ai demandé ce qu’il voulait dire. Il s’est effondré. Il a reconnu qu’il était rongé par des pensées suicidaires, qu’il ne pensait pas qu’il pourrait supporter [ce travail] plus longtemps et qu’il avait besoin d’aide. Mais il m’a suppliée de ne pas en parler à nos patrons.
J’ai pu l’aider à obtenir un traitement de son médecin généraliste, et en l’aidant, j’ai pris conscience que j’avais besoin d’aide, moi aussi. J’avais le sentiment que les choses horribles que je voyais obscurcissaient ma pensée, et j’étais en pleine dépression. C’était déjà un grand pas, mais il fallait que je me tire de là.
Après mon départ de l’abattoir, les choses ont commencé à aller mieux. J’ai complètement changé de vie et ai commencé à travailler pour des organisations qui viennent en aide aux personnes avec des difficultés psychologiques, qui les encouragent à exprimer leurs émotions et à solliciter une aide médicale, même s’ils pensent qu’ils n’en ont pas besoin ou ont l’impression qu’ils ne la méritent pas.
Quelques mois après mon départ, j’ai eu des nouvelles d’un de mes anciens collègues. Il m’a raconté qu’un homme qui avait travaillé avec nous, dont le travail consistait à dépecer les carcasses, s’était donné la mort.
Parfois, je me remémore mon temps à l’abattoir. Je pense à mes anciens collègues travaillant d’arrache-pied, comme s’ils faisaient du surplace en plein milieu d’un vaste océan, sans le moindre bout de terre à l’horizon. Je pense à mes collègues qui n’ont pas survécu.
Et le soir, quand je ferme les yeux et essaie de dormir, je vois encore parfois des centaines de paires d’yeux qui me dévisagent.
Propos recueillis par Ashitha Nagesh pour BBC News.
Traduit de l’anglais par nos soins.
Restez informés ! Pour ne rien louper de nos campagnes, des dernières nouvelles de l'association et des actions à mener pour défendre les animaux, inscrivez-vous à notre lettre d'info !