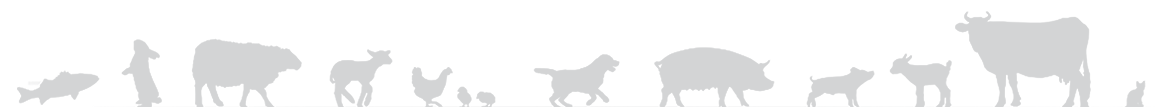Ahiṃsā. Violence et non-violence envers les animaux en Inde.
- Article du Lundi 21 avril 2014

Dans son dernier livre, toujours consacré à la question animale, Florence Burgat sort de son domaine de prédilection – la philosophie -, et de sa culture pour nous entraîner en Inde. Avec cet ouvrage, Ahiṃsā. Violence et non-violence envers les animaux en Inde, nous l’accompagnons durant une vingtaine de jours dans ce pays qu’elle a - courageusement ou inconsciemment - pris le parti de découvrir sans méthode ni savoir, sans idée préconçue sinon les plus communes (les « vaches sacrées », le pays du végétarisme… ).
En raison notamment de textes classiques indiens profondément empreints de compassion pour tous les êtres sensibles, du charisme du Mahatma qui prônait sans relâche l’ahiṃsā (non-violence qui inclut une dimension de bienveillance) et du végétarisme valorisé par plusieurs religions indiennes (hindouisme, bouddhisme, jaïnisme, sikhisme), l’Inde apparaît encore comme un modèle en ce qui concerne les animaux. Mais cette image de l’Inde, en tant que fondatrice de la non-violence, de la protection et des soins envers les animaux, est-elle réellement et encore pertinente ?
La première partie de l’ouvrage, intitulée Journal indien, nous permet de suivre Florence Burgat jour après jour, pas à pas dans un pays où tout lui est étranger, où les repères les plus communs disparaissent tandis que la fatigue exacerbe chaque difficulté – et ce ne sont pas elles qui manquent. Rédigé à partir des notes prises lors de son premier voyage de recherche en Inde, en février 1998, ce Journal indien restitue fidèlement de ce qu’elle voit d’« un regard non informé, par conséquent dépourvu de la distance que procure un savoir, aussi lacunaire soit-il. » Car tandis que Florence Burgat s’applique à collecter des données concernant les mouvements de défense des animaux, elle fait l’expérience de l’Inde immense, indiscernable et complexe. Insupportable de bruits, de crasse, de pollutions, d’odeurs, de chaleur. Sublime, aussi. En rapportant fidèlement et simplement dans son journal ce qu’elle voit chaque jour, sans tenter d’arrondir des angles souvent difficiles voire douloureux, l’auteure se raconte aussi, et la profonde empreinte de notre culture occidentale transparaît à travers une Mother India qui n’en finit pas de nous dérouter et de nous stupéfier.
Au fil des 110 pages de son Journal indien, l’auteure ne se, et ne nous, ménage pas. Visitant sans relâche associations et refuges pour animaux, enchaînant les rendez-vous, elle raconte le choc que constitue pour elle la rencontre avec l’Inde, pays de tous les paradoxes, et ne cache pas la fascination extrême qu’exercent sur elles ces personnes rayonnantes entièrement dévouées aux chiens faméliques, rongés par la gale et autres parasites – ces chiens de rue, traqués, inutilement électrocutés par dizaine de milliers depuis des décennies, mais pour lesquels des campagnes de stérilisations et de vaccination se mettent enfin peu à peu en place. Elle apprend que les animaux ne sont pas épargnés par la vivisection, que nombre de chiens, bovins et oiseaux sont blessés ou tués par le trafic croissant, que les vaches sont transportées dans des conditions épouvantables à travers tout le pays avant d’être égorgées à vif dans de sordides abattoirs (légaux ou non ; en 1997, le gouvernement découvre 36 000 abattoirs illégaux). Gandhi, déjà, dénonçait l’hypocrisie des hindous qui vendaient les « vaches sacrées » aux bouchers musulmans. Aucune réforme concernant l’abattage des animaux n’est entreprise par le gouvernement, notamment par crainte de froisser l’une ou l’autre des nombreuses communautés religieuses qui composent l’Inde.

Vache se nourrissant de carton (Inde)
Elle nous parle de ces hommes qui, tous les matins depuis douze ans, entravent l’entrée des animaux aux abattoirs de Mumbai. Invariablement arrêtés et conduits au commissariat, ils sont retenus le temps que les animaux soient tués. Elle visite, entre autres, la Société pour la prévention de la cruauté contre les animaux (SCPA) à Mumbai et, à Delhi, le Jaïn Birds Hospital, un sanctuaire pour chevaux et ânes géré par des Turcs musulmans, et le Sanjay Gandhi Memorial Animal Care Center, qui se révèle être un insupportable mouroir où, faute de moyens et de savoir-faire, chiens, bovins et singes meurent lentement de faim et de maladies…. Elle se rend dans des goshalas et des pinjrapoles, institutions d’accueil pour animaux improductifs, âgés, informes ou abandonnés, dont les premières formes remontent à trois mille ans. S’ils abritent souvent majoritairement des bovins, on y rencontre aussi des lapins, des poules, des oies, des daims… Les animaux y sont amenés par leur ancien propriétaire, d’autres trouvés errants, ou achetés sur les marchés. Certains centres retirent un certain profit de la vente du lait, mais les vaches ne sont traites que lorsque que leur veau a terminé sa tétée. Les vaches y font parfois l’objet d’une telle douceur que l’auteure note que « Le fait de les traiter avec tant de respect laisse se développer en elles une majesté et une grâce tranquille, qu’écrase d’emblée la violence de la plupart des activités habituelles, où les animaux, simples moyens malmenés, sont réduits à la peur des gestes brutaux et assassins. »
Constituée de données sur la condition animale en Inde, la postface éclaire les faits rapportés dans le Journal. Florence Burgat y propose des éléments concernant la législation indienne, analyse le mythe des « vaches sacrées », relève l’existence des sacrifices animaux dans l’hindouisme et de mouvements végétariens dans la communauté musulmane, et fournit des éléments historiques et anthropologiques. Enfin, le livre s’achève sur des textes de Gandhi inédits en français et une présentation du Bureau de la protection animale en Inde (AWBI) de Madras.

Pigeon recueilli au Delhi bird's hospital
La lecture de Ahiṃsā. Violence et non-violence envers les animaux en Inde déroute autant que cette Inde, perpétuellement tiraillée entre les diverses influences qui l’ont construite. S’il s’avère que par bien des aspects le sort des animaux y est aussi dur qu’ailleurs, que l’Inde est même le deuxième pays au monde exportateur de cuir, c’est un pays dans lequel le végétarisme est encore fortement valorisé (malgré une consommation de viande en augmentation) et où la bienveillance envers les animaux peut se développer d’une façon admirable.
Mais l’Inde n’a, heureusement, pas l’exclusivité de la compassion. J’en veux pour preuve la mobilisation tout récente en Allemagne des riverains d’une exploitation laitière qui, décidés à ne pas laisser le troupeau partir pour l’abattoir, ont racheté toutes les vaches et ont créé l’association Kuhrettung Rhein-Berg afin de financer leur nourriture et leurs soins. Gageons que ce goshala occidental est le premier d’une longue série !

Dans un goshala
Florence Burgat, Ahiṃsā. Violence et non-violence envers les animaux en Inde, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2014.
En apprendre plus sur le site des Éditions de la Maison des sciences de l'homme