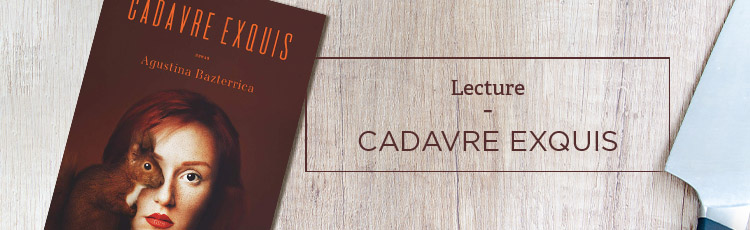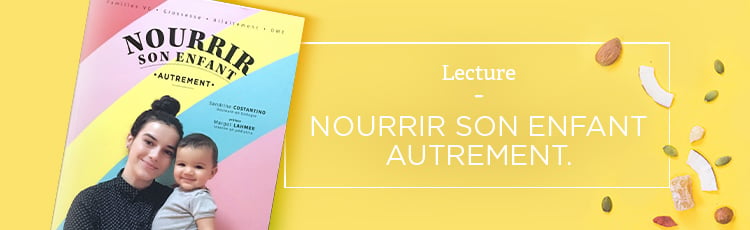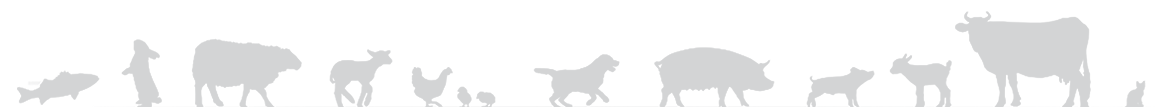Désillusion dans un élevage laitier : une ancienne employée témoigne
- Article du Vendredi 26 juin 2020

Susana Romatz a eu beaucoup de mal à faire face psychologiquement aux exigences du travail chez un producteur de lait de chèvre – un travail qui requiert, par exemple, de séparer les mères de leurs petits : elle a fini par dire « trop, c’est trop ».
Susana Romatz ne se considère pas comme une enfant d’éleveur en tant que telle, mais son grand-père élevait tout de même des lapins pour leur viande. Avec le recul, elle admet que c’est sans doute ce qui lui a donné très tôt les « outils de la dissociation ». « Je savais ce qu’il faisait d’eux, et ça m’a appris à faire taire mes sentiments », raconte-t-elle.
C’est cette capacité à se détourner de ses émotions et de son instinct qui a permis à cette ancienne flexitarienne, devenue aujourd’hui vegan (et fabricante de fromages végétaux), de travailler comme ouvrière agricole dans un élevage de chèvres de l’ouest de l'Oregon [ndlt : aux États-Unis]. Une expérience dont cette amoureuse des animaux essaie encore de se remettre.

© refuge GroinGroin
À l’époque, Susana était une jeune enseignante à la recherche d’un travail d’appoint pour arrondir ses fins de mois. Elle avait envie d’un emploi physique et au grand air. Cette partie de l’Oregon est considérée comme étant plutôt progressiste, explique-t-elle. Les produits estampillés « éthique », « élevé en plein air » ou « bio » abondent. Alors, quand un élevage de chèvres « respectueux du bien-être animal » a cherché à recruter, elle s’est montrée partante. « J’ai en quelque sorte commencé à adhérer à cette idée qu’on peut élever des animaux de manière respectueuse », se souvient-elle. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que « ce raisonnement commence à s’effondrer sur lui-même ».
Ce qui faisait de cet élevage – qui produisait du lait et du fromage et vendait des chèvres pour leur viande – un élevage « respectueux », c’était le fait que les animaux étaient élevés en plein air. « Ils avaient beaucoup de terrain » raconte Susana, et il s’agissait d’une entreprise « familiale ». Elle s’est pourtant très vite rendu compte que tout cela ne voulait pas dire grand-chose. « Même si c’était le niveau au-dessus en termes de respect, de compassion envers les animaux, il y avait malgré tout des choses qui me dérangeaient vraiment. »
En haut de la liste se trouvait l’ébourgeonnage sans anesthésie des chevreaux. L’ébourgeonnage est une pratique standard en élevage, qui sert à interrompre la croissance des cornes et, soi-disant, à éviter la destruction de biens et les blessures. (Les blessures causées à un animal par les cornes d’un autre se produisent en général dans des espaces confinés.) La plupart des groupes de défense du bien-être et des droits des animaux s’opposent à cette pratique lorsqu’elle est effectuée sans anesthésie ; elle reste néanmoins communément employée.
« C’était vraiment horrible, se souvient Susana. [Les chevreaux] poussaient des cris perçants. [Les éleveurs] devaient les maintenir au sol et carrément brûler les bourgeons de leurs cornes avec un tisonnier électrique ». Elle raconte que certains chevreaux ne s’approchaient plus jamais des humains après ça. « C’est une des choses que j’ai vraiment dû me forcer à refouler. Je devais m’empêcher d’y penser. Je voyais bien que c’était très, très douloureux. »
Susana raconte qu’à l’époque, elle essayait de justifier ces pratiques en considérant l’élevage comme un compromis. « Avec l’élevage, il faut faire des concessions quand on considère les animaux comme des marchandises, peu importe à quel point on les aime. On ne peut pas faire de profit sur leur corps sans prendre des décisions discutables », pensait-elle à une époque. « Quand on utilise les animaux de cette façon, on est obligé de prendre ce genre de décision » pour faire des bénéfices.
Mais même quand elle essayait d’adopter une approche pragmatique, d’ailleurs très similaire à celle des éleveurs chez qui elle travaillait, Susana a toujours senti, au fond, que tout cela était mal. « Une telle marchandisation des animaux, de leur lait et de leurs corps, faire en sorte que les chèvres attendent des petits quasiment en permanence, les nourrir de céréales [au lieu de leur alimentation naturelle] toute l’année pour les maintenir en lactation, je savais que tout cela était éprouvant pour leurs corps. »

© refuge Edgar's Mission
La séparation des mères et de leurs nouveau-nés pesait aussi beaucoup à Susana. « Les chevreaux étaient presque immédiatement pris à leurs mères », raconte-t-elle. Dans l’industrie laitière, les mères et les petits sont habituellement séparés afin de récupérer le lait pour la consommation humaine. Dans le cas des chèvres, les éleveurs chez qui elle travaillait ont raconté à Susana qu’il était nécessaire de séparer les mères et les chevreaux à cause d’un virus, l’arthrite-encéphalite caprine, qui se transmet via le lait de la mère. (Effectuer un test sanguin afin d’identifier les animaux infectés et les séparer du reste du troupeau est aussi une solution efficace.)
Il était impossible de nier que les mères appelaient leurs petits et réciproquement, raconte Susana. « C’était une chose à laquelle j’étais confrontée quotidiennement pendant la saison des naissances, quand il y avait plein de chevreaux rassemblés dans un enclos et plein de mères dans d’autres enclos. On pouvait les entendre s'appeler les uns les autres. » Cependant, seules les chevrettes étaient isolées, car seules les femelles devaient rester en bonne santé afin que l’éleveur puisse un jour les inséminer à répétition et qu’elles produisent du lait sans fin. Ce n’était pas un problème si les mâles, eux, étaient infectés, parce qu’ils seraient de toute façon envoyés à l’abattoir à deux ou trois mois. « C’était vraiment triste quand on sait quelle était leur destination », raconte-t-elle à propos du jour où les chevreaux mâles étaient vendus.
Afin de supporter psychologiquement ce travail, que Susana a fait pendant trois ans, « on est obligé d’augmenter son seuil de tolérance, on l’augmente jusqu’à ce qu’on finisse par se dire “Ouah, comment j’ai fait pour supporter ça tous les jours ?” »
Susana a fini par quitter l’élevage pour se consacrer à l’enseignement. Elle raconte que ça a été un soulagement de ne plus avoir à bloquer mentalement de nombreux aspects de son activité professionnelle. « Tous ces efforts qu’on fait pour contenir ces pensées, on finit par ne plus en être capable et c’est l’inondation. Et quand ça arrive, on ne peut plus jamais voir les choses comme avant. »
Susana est devenue vegan deux ans après avoir quitté l’élevage. Elle raconte qu’après qu’elle et son compagnon aient adopté un chien, « mon compagnon m’a envoyé un texto qui disait “Je ne peux plus consommer de produits animaux” et c’est arrivé tellement vite que j’ai réussi à faire la transition. Ça m’a pris peut-être une demi-heure. » Elle a senti que c’était ce qu’il fallait faire. « C’était comme si tout s’alignait à ce moment-là. Tous ces doutes et ces émotions que j’avais ressentis tout ce temps, et contre lesquels je m’étais battue ou dont j’avais essayé de me dissuader : c’était de la dissonance cognitive. » Elle se souvient d’une « constante bataille intérieure, de faire des choses qui allaient à l’encontre de ses valeurs. » En décidant de devenir vegan, « ça a été facile de laisser tout ça derrière moi. [J’ai compris] que c’était une illusion, un mensonge destiné à me faire dépenser de l’argent, un mensonge pour m’empêcher de chercher plus loin. »
Son seuil de tolérance s’est immédiatement abaissé.

© refuge GroinGroin
Aujourd’hui, Susana ressent le besoin de racheter son passé. En plus d’être vegan, elle fait la promotion des fromages végétaux. Elle a commencé à faire ses propres fromages par nécessité, à partir de noisettes locales et de ferments spéciaux qu’elle a créés elle-même. La fabrication demande beaucoup de travail et coûte cher (elle précise que les producteurs de noix, noisettes ou amandes ne sont pas subventionnés comme le sont les producteurs laitiers), alors, pour le moment, Susana se contente de faire des fromages pour sa famille et ses amis. Elle a un profond désir d’informer les autres : elle vend ses ferments vegan et partage informations et recettes sur son site internet « afin de donner aux autres les outils pour faire ces fromages eux-mêmes. »
À propos des propriétaires de l’élevage de chèvres, qui est toujours en activité à l’heure actuelle, Susana affirme que « ce ne sont pas de mauvaises personnes ». Ils ont juste des perspectives différentes. « Les [éleveurs] plus âgés considéraient plutôt les animaux comme des biens, explique-t-elle. Ils prenaient soin des animaux aussi bien que nécessaire [pour qu’ils soient rentables]. »
Susana est persuadée que les messages dont nous bombardent les médias, notre culture, nos traditions et nos familles donnent lieu, chez certains d’entre nous, à « une dissociation de la réalité de ce que nous vivons ». Elle raconte qu’il lui a fallu plusieurs années avant de pouvoir vraiment comprendre tout ce qu’elle a vécu dans cet élevage, « avant [qu’elle] puisse vraiment intégrer tout ce qui s’est passé, [qu’elle] réalise [qu’elle s’était] leurrée [elle]-même pour être capable de travailler là-bas ».
Aujourd’hui, Susana va de l’avant, même si elle n’oubliera jamais les animaux de son passé. « J’essaie vraiment d’avoir de la considération pour la vie des animaux qui ne sont plus là aujourd’hui. Mais pour comprendre et avancer, on n’a pas forcément besoin de se plonger dans les traumatismes du passé ; il faut les comprendre et en être conscient, mais il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Réfléchir à [mon expérience], mais aussi être capable d’aller de l’avant ont été très importants pour moi. »
Ce témoignage nous vient des États-Unis. Pour autant, les pratiques décrites sont tout aussi valables en France, premier producteur mondial de fromage de chèvre.
En France aussi, les chevreaux sont séparés de leur mère dès la naissance, les mâles sont vendus pour leur viande et abattus très jeunes (entre 6 et 8 semaines), les femelles sont inséminées artificiellement et enchaînent les naissances pour produire le plus de lait possible. Lorsque leur productivité est jugée insuffisante, elles sont « réformées » et envoyées à l’abattoir, à l'âge de 4 ans en moyenne (alors qu’elles ont une espérance de vie de 15 ans environ). En France aussi, l’écornage sans anesthésie est une pratique courante. La plupart des chèvres passent de plus leur vie enfermées, sans accès à l’extérieur.
Grâce aux nombreuses alternatives végétales, il est aujourd’hui très facile de se passer de produits laitiers et de viande, sources d’importantes souffrances pour les animaux. Découvrez de nombreuses astuces et recettes sur notre site Vegan Pratique !
Article de Jessica Scott-Reid, initialement publié par Sentient Media.
Traduit de l’anglais par nos soins.