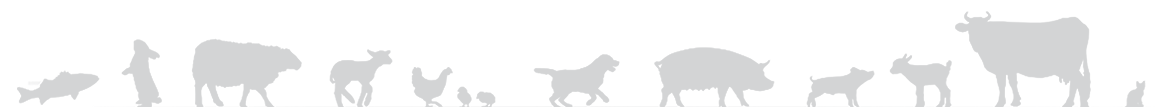Un séjour en France. Chronique d’une immersion.
- Article du Dimanche 25 octobre 2015

Dans ce livre Un séjour en France, Bérangère Lepetit, journaliste, rapporte son vécu après avoir travaillé quatre semaines à l’abattoir Doux, à la section du conditionnement des poulets. À aucun moment, elle ne parle de la façon dont les animaux sont tués, ni élevés. De toutes façons, elle n’a rien vu du massacre, puisque les bâtiments sont séparés et, à moins d’y travailler, on n’entre pas dans la section d’abattage, car « il est malvenu de poser des questions, de s’aventurer dans le reste des bâtiments ». Ensuite, ce n’est pas sa préoccupation, même si elle s’interroge : « Chaque jour, chaque nuit, les cinq cent mille poulets qui passent entre nos mains sont ensuite congelés, et les cartons chargés dans des poids lourds qui prennent la route du port de Brest. Et avant, comment se passe l’électrocution ? Et ensuite, où vont-ils précisément ? »
Elle finit par apprendre que ces poulets fournissent les étals en Arabie saoudite et en Afrique, rien de plus. Une recherche sur Internet me confirme que ces poulets sont étourdis par un bain électrifié avant d’être tués par décapitation et qu’ils sont en effet destinés à l’exportation.
 Entre deux mondes
Entre deux mondes
C’est pour son journal Le Parisien que Bérangère Lepetit a plongé dans le monde de l’abattoir Doux. Son objectif était d’en savoir plus sur la vie à l’usine : elle a donc vécu avec ses tripes le quotidien d’un de ses employés. Elle a découvert « une planète à part », marquée par la mixité culturelle, linguistique et religieuse : 27 nationalités y sont représentées à travers 650 employés, essentiellement des femmes.
Pour gagner leur confiance, et surtout pour ne pas créer de distance sociale, elle n’a jamais révélé son vrai métier, et s’est trouvée ainsi psychologiquement écartelée entre son rôle d’ouvrière et sa profession de journaliste. En plus, le premier jour de son arrivée à l’usine a eu lieu la tuerie de Charlie, et la voici loin de son journal parisien, ouvrière à la chaîne dans une usine en Bretagne. Le jour de l’attentat, elle travaillait dans l’usine de charcuterie Monique Ranou, où elle a passé deux jours avant d’aller chez Doux. Deux journées terribles, où, écœurée par les odeurs et pétrifiée par le froid (4°C), l’immobilité et l’ennui, elle s’est sentie devenir une machine. Chez Doux, la température est meilleure : il fait 7°C. Et le poulet mort ne sent pas grand-chose à 7°C.
Le corps est là, douloureux, mais l’esprit est ailleurs.
À l’usine Doux, le travail commence avec le pointage et est réglé toute la journée à la minute près. Pendant la journée, beaucoup préfèrent ne pas savoir l’heure – ce temps figé, « mortellement long ». Les montres sont d’ailleurs interdites pour des raisons de sécurité, et aucune horloge n’est accrochée aux murs. Les bruits permanents, intenses, métalliques, stridents ou graves, finissent par rendre sourd malgré les protège-oreilles et interdisent toute conversation. Bérangère Lepetit travaille « aux cartons » : elle place des poulets emmaillotés dans du film bleu blanc rouge dans des cartons. Sa seule initiative consiste à choisir la taille du carton selon le poids des poulets qui arrivent : 1,6 kg ou 650 g. La torpeur et l’hébétude ont vite raison d’elle, mais elle est stupéfaite de la résistance et de la rapidité des autres employés, rodés au travail, tandis qu’elle peine à suivre la cadence. Elle a le sentiment que tous sont « des paires de bras qui fonctionnent sans vraiment savoir pourquoi, sans vraiment savoir pour qui, dans le grand cercle vicieux de l’indifférence et de l’ennui généralisé ». Le corps s’habitue aux gestes cent mille fois répétés, ou du moins donne l’impression de s’habituer : tendinites et prises de comprimés antidouleur sont le lot quotidien de nombreux employés. D’autres tiennent grâce à l’alcool. La médecine du travail, totalement débordée, a depuis longtemps déclaré forfait.
Le bâton et la carotte
L’auteure s’intègre facilement, se rendant compte que c’est notamment dû au fait qu’elle est française – celles et ceux qui parlent mal français, incapables de communiquer verbalement, vivent sur la défensive et sont victimes d’ostracisme. Elle découvre des copinages, des jalousies, des clans.
Comme les autres, elle connaît l’affreux accablement du lundi et l’insoutenable impatience du vendredi. Et pourtant, dans cette usine qui embauche à tour de bras en CDD et en intérim, le CDI est vu comme un graal. Quand on a des bouches à nourrir et des traites à payer, Doux « ce n’est pas la panacée mais c’est de l’argent ». La peur du chômage, les plans sociaux, restructurations, débauches et embauches font frémir les ouvriers. L’arrivée de nouvelles machines pour remplacer les bras fait peur aussi : comment rivaliser avec ces « masterpacks » capables d’emballer 7000 poulets à l’heure, sans tendinite ni ralentissement ?
Ces ouvriers payés au SMIC tendent tous vers le même objectif : gagner des « pépettes », toujours plus de « pépettes ». On aspire à la médaille du travail pour toucher la prime qui va avec. On espère aussi gagner du galon, quitte à faire un peu de délation, et pouvoir ainsi, de temps en temps, quelques heures par jour, changer de service, c’est-à-dire changer de gestes. À certains postes, on est même assis. En plus des règles d’hygiène draconiennes (pas de parfum, pas de maquillage, pas de vernis à ongle, pas de faux-ongles, pas de bijoux, etc.), les employés n’ont pas le droit d’avoir d’objets « à usage non professionnel » à leur poste de travail, donc pas de portable, pas d’encas, pas de bonbon. Beaucoup détournent les règles et ne boutonnent pas leur blouse jusqu’au col, mâchent du chewing-gum, téléphonent aux toilettes, se passent des bonbons à la menthe. Autant de minuscules entorses au règlement qui donnent à l’auteure l’impression d’être une rebelle dans cet univers rétréci, où les conversations tournent autour des ragots, des comprimés antidouleur, du prix des boissons au distributeur et des mini-compotes du supermarché du coin.
Les employées ont quand même le droit d’aller aux toilettes (singulièrement puantes et sales) en dehors des pauses en cas « d’envie pressante », mais chaque sortie dérange plusieurs personnes et oblige à passer devant les bureaux vitrés des chefs situés à l’entrée d’ateliers, surnommés « la guillotine ». Bref, on se retient.
Ruiner sa vie à détruire des vies
Situé cœur de la Bretagne, Doux est entièrement spécialisé dans la production de poulet halal exporté à 100%.
25 000 poulets sont tués chaque heure dans cet abattoir qui tourne 24 h sur 24. 600 000 poulets par jour. 21 900 000 oiseaux par an. Des chiffres vertigineux à la mesure du plus grand abattoir de poulets de France.

Le travail y est extrêmement pénible et ennuyeux, parfois dangereux. Les parents de la région menacent même leurs enfants indisciplinés de finir à Doux, version modernisée du bagne, s’ils ne sont pas sages.
Les conditions de travail sont probablement les mêmes dans tant d’autres usines agroalimentaires. Des milliers de personnes passent ainsi leurs journées, des années, une vie entière à tuer, découper ou emballer des animaux. L’impératif de « gagner sa vie » ne laisse pas la place aux questionnements éthiques, même si « chez Doux, les gens finissent par ne plus manger beaucoup de poulet. Une overdose de volaille les saisit quand ils rentrent chez eux le soir ». L’auteure dit manger moins de viande suite à cette expérience.
La division du travail dans les abattoirs, qui débuta aux États-Unis à partir du milieu du XIXe siècle, a ouvert la porte à la déresponsabilisation, l’ouvrier n’étant plus qu’un minuscule rouage d’une énorme machine que rien n’arrête. L’éleveur élève les poulets, le routier ne fait qu’apporter les animaux à l’abattoir, un autre tue les animaux qui de toutes façons sont là pour ça, des ouvriers découpent des corps déjà morts, d’autres les emballent, et le consommateur ne fait que les manger. C’est pourtant dans les abattoirs que le travail est le plus dur : le turn-over y est conséquent et l’alcoolisme fait des ravages, surtout chez ceux qui tiennent le poste de tueur.
Cette répartition du travail liée à la mécanisation permet aussi d’atteindre des taux de production gigantesques, à l’image des trois millions d’animaux terrestres tués chaque jour, en France. Dans cet univers démentiel où tout est ultra organisé, huilé, chronométré, les animaux ne sont que de la matière première, une chair à rentabilité, dont la vie n’a plus aucune valeur.

Titou, poulet rescapé.
Pour aller plus loin : Manuela Frésil, Entrée du personnel, Ad libitum, 2011. Documentaire.
Bérangère Lepetit, Un séjour en France. Chronique d'une immersion, Éditions Plein Jour, 2015.