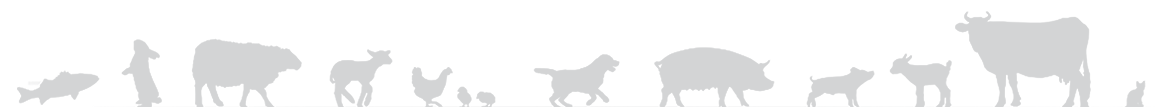Sarah*, 18 ans, est étudiante en BTS de photographie. Sensible à la cause animale, elle a voulu voir de ses propres yeux la réalité des abattoirs. En mai dernier, elle a pu visiter un abattoir dans le cadre des « Rencontres made in viande », organisées par l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev). Elle a souhaité partager ce récit, écrit dans les jours suivant la visite.
Il est 9 h 15, nous arrivons à l’abattoir. La pluie est forte, le vent nous fouette le visage. La première chose que je vois en sortant la tête de la voiture est une petite brebis morte, abandonnée sur le goudron à côté d’une bâche. Elle a dû mourir pendant le transport. Très vite, j’entends les bêlements des moutons, qui me transpercent comme des poignards. Leurs cris retentiront à mes oreilles jusqu’à la fin de ma vie.
Le début d’un cauchemar sans nom commence. J’ai peur. Nous entrons dans un grand bâtiment poussiéreux et sombre. Nous rencontrons le directeur de l’établissement, qui a l’air heureux de nous voir et de nous faire visiter les lieux. En discutant avec lui, nous comprenons rapidement que l’abattoir est encore en marche, qu’il n’a pas interrompu son activité le temps des visites. Ça représenterait trop de pertes. Moi, je n’arrive même plus à parler, je ne veux pas ouvrir les yeux et regarder les petits agneaux terrorisés par le bruit et surtout par les humains. Des moutons se jettent les uns sur les autres et se précipitent de l’autre côté de leur enclos dès qu’une personne passe à proximité. Le bâtiment est sale, il y a de la mort-aux-rats sur le sol, de la poussière. Des enclos, où devraient s’entasser des moutons, des agneaux et des brebis, sont désormais vides et maculés d’excréments. Où sont ces animaux à présent ?

Crédit photo : SC
Il est 10 h 15, la visite commence. Nous entrons dans un sas blanc, l’odeur est à la limite du supportable. À ma droite, des outils de découpe ; par terre, à mes pieds, du sang ; au plafond, des crochets sales. J’angoisse. J’enfile une blouse blanche, une charlotte, un masque et des surchaussures en accord avec la « norme d’hygiène ».
Nous passons une première porte… La chambre froide. Des cadavres numérotés sont pendus à des crochets. La salle est parfaitement blanche, la lumière est agressive, j’ai froid. Dans le couloir, des poumons, des estomacs, des foies sont posés sur une étagère. Il y a de nombreuses têtes de veaux sans yeux, ni langue, ni peau. Nous arrivons vers une grande salle où les animaux sont découpés. Par une ouverture sur la droite, je vois des moutons pendus par les pattes, se débattant désespérément. J’essaie de garder mon sang-froid et suis le directeur qui commente la visite. Je ne l’écoute pas. Je baisse les yeux : du sang. Je tourne la tête : un employé pousse un chariot rempli de peaux de mouton. Je ne peux pas pleurer, je ne peux pas partir…
Nous nous dirigeons vers l’ouverture. Je me cache derrière une autre personne pour ne pas être obligée de voir les cadavres pendus. Un opérateur arrache la peau des moutons avec une machine ; nous voyons les muscles encore palpitants des animaux qui viennent d’être tués. L’employé suivant décapite les moutons avant de jeter leurs têtes dans un bac vert. Il y a du sang partout. L’homme chargé de couper les oreilles en est couvert, on ne distingue presque plus le blanc de son tablier. Les cadavres sont manipulés sans gants, avec des mains sales…
Le directeur me regarde dans les yeux, il essaie de comprendre ce que je fais ici. Je reste neutre. Je ne veux pas comprendre ce qui se passe, je ne veux pas regarder les animaux morts, et surtout, j’arrête de compter les carcasses qui défilent devant moi. J'enfonce mes ongles dans les paumes de mes mains pour m’empêcher de pleurer. À chaque cri, ma gorge se serre un peu plus. J’ai la main en sang.
Je suis entourée de futurs bouchers qui s’émerveillent devant les cadavres sanglants. Ils se moquent de moi et me demandent ce que je fais ici, ils me dévisagent, me disent que je n’ai pas la tête d’une fille qui pourrait travailler dans les abattoirs.
J’ai joué un rôle jusqu’au bout. J’ai tenu jusqu’au bout…
« L’abattoir est un endroit très bruyant » m’a-t-on dit avant d’entrer dans le bâtiment. Les machines claquaient fort, les crochets auxquels étaient pendus les cadavres faisaient un bruit métallique en frottant contre le circuit. Les éclats de rire et les appels des employés retentissaient entre les cris. L’odeur du sang était insupportable.
Je n’ai pas été autorisée à voir la mise à mort des animaux. Mais j’ai vu les étapes après l’abattage. Le moment où le mouton est « mort » et où son corps se tétanise, après qu’on lui a tranché la gorge ; le moment où son sang se vide et se déverse dans le caniveau. Sous les casques des ouvriers, j’ai vu des visages que l’on pourrait croiser en ville, dans le petit commerce du coin… J’ai entendu les cris, les flots de sang coulant des cadavres sans tête sur le sol, les machines arrachant la peau du corps, le couteau sectionnant la tête, les scies découpant les os, les rires, les hurlements… J’ai senti l’angoisse, la peur de l’autre côté du mur, là où se trouvait, à moins de 5 mètres de moi, le couloir de la mort. J’ai respiré l’odeur du sang, du désinfectant, de la sueur, des excréments. J’ai touché les portes humides, grasses et couvertes de sang. J’ai serré la main du directeur et des employés. J’ai vu des hommes sans gants séparer les côtes de la chair de l’animal avec des couteaux parfaitement aiguisés. J’en ai aussi vu remettre une côte tombée par terre dans le bac avec les autres, sans un mot. J’ai croisé le regard d’agneaux innocents et très jeunes, envoyés si tôt à l'abattoir parce que leur chair est plus « tendre ». J’ai vu la panique dans leurs yeux.

Crédit photo : SC
Plus de 500 animaux à abattre dans la journée. Ici, l’abattoir est ouvert 24 heures sur 24. On ne peut pas arrêter la machine, cela coûterait trop cher, et l’argent passe avant tout. Avant les animaux, avant l’empathie, mais surtout avant le respect.
Le directeur a beaucoup parlé pendant la visite, il a cité des chiffres, des chiffres et encore des chiffres. Oui, il parlait des tonnes d’animaux tués chaque année dans son établissement avec fierté. Il les classait par catégories. J’ai préféré ne pas les retenir.
À un moment pendant la visite, il m’a prise sous son aile, j’étais derrière lui. Avant d’arriver dans la salle où les moutons sont pendus par les pattes, il est venu vers moi et a fermé le col de ma blouse en prenant soin de me dire : « C’est pour protéger tes vêtements, tu risques de les salir, parfois ça éclabousse. » Mais je ne compte pas remettre les vêtements que j’ai portés ce jour-là.
Je n’arrive plus à dormir, j’entends encore les cris des animaux, je vois encore ces moutons pendus. Je n’arrive pas à sortir ces images de ma tête. Je n’ai rien pu faire. Je n’arrive plus à attraper un couteau sans y penser, je n’arrive plus à regarder mes animaux en face sans me dire que ça aurait pu être eux.