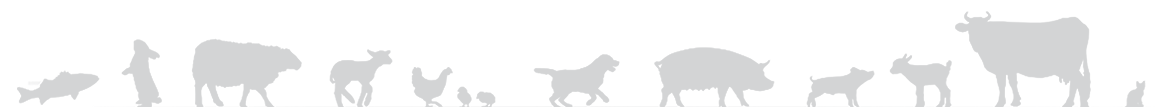Où et comment produit-on « la viande » ? Est-ce qu'on veut vraiment le savoir ? Et quand on l'apprend, on fait comment ? On détourne le regard ? On change ? On se laisse porter par cette prise de conscience ?
Peut-on revenir en arrière ?
Pas vraiment ! 180 jours, le roman d'Isabelle Sorente parle, nous dit Victoria Luta, de l'impossibilité de tout retour en arrière. Vous vous reconnaissez dans l'histoire de son protagoniste ?
######
« Un porc à ton avis, c'est quelqu'un ou quelque chose ? »
180 jours est la durée de vie d'un être sensible venu au monde par insémination artificielle, sevré, engraissé, sacrifié et découpé pour devenir « de la viande » : du jambon, du lardon, du boudin, des côtes grillées, de la saucisse, du museau au vinaigre, de la gélatine pour les bonbons. Se figurer – en regardant le jambon, le lardon, le boudin, les côtes grillées, la saucisse, le museau au vinaigre, les bonbons – le trajet en sens inverse, prendre conscience que tous ces « produits » ont été, d'abord et avant tout, les morceaux du corps d'un être ayant respiré, vécu et tissé des liens sociaux dont il a été arraché, cela tient, aujourd'hui, d'une difficulté entretenue par tous les moyens dans notre société.
De nos jours, les élevages et les abattoirs sont des lieux industrialisés, normés, hygiénisés, aseptisés. Les derniers sont situés généralement bien loin des yeux et des consciences des consommateurs. Ce sont des entreprises où la mise à mort des bêtes fait oublier, par sa cadence infernale, « la matière » qui s'y trouve, où les maladies professionnelles pullulent, les cauchemars « de la découpe » et les cris entendus sans arrêt hantant les vies des employés en dehors de ces murs ensanglantés. L'opacité sert le commerce : une telle incapacité à voir des évidences, soigneusement cultivée, fait que le consommateur peut continuer à acheter et à manger, sans se poser trop de questions, du jambon, du lardon, des côtes grillées, de la saucisse, du museau au vinaigre, des bonbons gélatineux.
Être et savoir
Martin Enders, le narrateur de 180 jours, à la quarantaine tiède et raisonnable, semble assez confortablement installé dans sa vie partagée entre être et savoir. Mais il a la (mal)chance de se poser des questions. Il le fait par vocation et avec de la méthode, en tant que professeur de philosophie dans une université parisienne. Quand il sera chargé de préparer un séminaire sur un sujet qui lui demeure peu connu – « l'animal » –, il partira donc visiter une porcherie industrielle afin d'y puiser les idées nécessaires. A partir de là, toute sa vie va changer. Profondément.
« Son » roman s’ouvre par un sursaut nocturne et finit dans un spasme cérébral : voici la trajectoire habituelle des « rescapés ». Entre ces deux moments, Martin Enders passe du temps à la Source, « exploitation » abritant 15 000 porcs et six employés, et connaît la métamorphose que toute descente en enfer procure. Son regard s'en saisit dès le premier instant : « Les sept bâtiments parallèles attendaient derrière la colline, de loin, ils rassemblaient aux centres commerciaux en bordure d'autoroute avec leurs magasins de pièces détachées ou de meubles en kit. Sauf que les pièces étaient vivantes » (p. 137). Ces bâtiments délimitent les étapes de l'existence d'un cochon vivant 180 jours, passant de la conception par l'engraissement, pour être enfin prêt pour « l'embarquement » auquel il avait été destiné avant qu'il ne soit né.
Le roman d'Isabelle Sorente, 180 jours (Éditions Jean-Claude Lattès, Paris, 2013), nous livre, à la première personne, le récit d'une plongée dans une révélation des plus déconvenables : Martin Enders comprend comment se produit, de nos jours, ce que l'on appelle « la viande ». (Est-ce un hasard ? En était-il « prédestiné » par les échos fragilisants de son adolescence brimée ? Avait-il connu, de par ses expériences, des mises en situation d'empathie ? La fille de son supérieur universitaire, Tico, qui refuse la viande et se montre douée à irriter les adultes bienséants, lui a-t-elle instillé un doute initial ?) Le choc cognitif et émotionnel de Martin Enders est aussi simple et aussi torturant que cela. Il en sortira laminé.
L'enfer
La découverte dont Martin Enders est sujet brûle l'intellect, perturbe la sensibilité, dérègle le corps et trouble les sens. Sa vie sociale et intime sera, elle aussi, tourmentée jusqu'aux dernières conséquences. Le savoir qu'il acquiert à la Source fissure, brise et finit par dévorer son être, au propre et au figuré.
L'intercesseur de sa descente en enfer est, pour le philosophe de la capitale, un jeune porcher à bout de souffle, aux poumons chargés des toxines et au sobriquet romantique à la Dumas fils : Camélia. Une amitié atypique se lie entre Enders et cet homme qui a l'insomnie tenace et les joues creuses, qui se montre rongé par des questions, tenaillé par des doutes et sait tenir un drôle de discours : « ...ces femelles qu'on insémine à peine elles ont mis bas, si tu voyais comme elles te regardent quand leurs petits partent pour le bâtiment D (Post-Sevrage). Certaines chialent, elles deviennent folles. Et sept jours plus tard, elles sont de nouveau en chaleur. Le stress les inonde d'hormones qui donnent envie de remettre ça. La nature est une salope, ce qui arrange bien la production. Elles accouchent en même temps, elles stressent en même temps, elles sont chaudes en même temps et leurs petits partent par le même camion. Et ça recommence. Toute cette vie qui n'arrête pas, c'est comme une lumière toujours allumée qui supplierait qu'on la laisse s'éteindre. Comme si je forçais quelqu'un à ne jamais dormir » (p. 152).
Le désordre commence, comme dans toute histoire initiatique, par un interdit transgressé : Camélia donne un nom à un animal assigné à la « production » chiffrée. Il appelle Marina une femelle mettant bas sans cesse, « la truie numéro 1000788 » (p. 246). Or, reconnaître une identité à un être vivant dans cet univers concentrationnaire représente un scandale, la faille qui ouvre les consciences et permet à la tragédie des humains et des bêtes de s'y propager comme un vent de folie.

En proie à une consternation fascinée, Enders retourne plusieurs fois à la porcherie de la Source. Immergé dans le milieu « des paquets de chair rose qui gigotent » (p. 67), confronté aux limites de son être et de son savoir, guetté par l'angoisse et des épisodes d'hypervigilance, pour Enders, le porc devient son « autre » viscéralement proche, son double inavouable, son reflet meurtri, voire meurtrier (un épisode d'une grande force épique raconte l'infanticide de Marina, la truie « clairvoyante » à l’œil bordé de noir, qui a l'air de supprimer consciemment ses porcelets destinés à l'abattoir). Enders se découvre un ressenti solidaire avec le porc, et le porc, à son tour, semble le regarder d'un œil philosophe et médusant. On assiste à l'animalisation de l'humain et à l'humanisation de l'animal, à une fonte d'identités magistralement et minutieusement décrite.
Parmi tous les « symptômes » étranges de la porcherie, le plus intéressant – en ordre humain et romanesque – est sans doute le jet-lag, contretemps provoquant l’hypertrophie d'une sensibilité générique, tant humaine qu'animale :
« Le décalage entre la porcherie et le monde extérieur ne se manifestait pas seulement par de la nervosité ou des troubles de sommeil, il modifiait le rapport entre les individus, décalait les uns par rapport aux autres. Ce qui m'avait réveillé était la sensation qu'à cet instant même, Camélia se réveillait. Soudain quelqu'un se retrouve à la place de quelqu'un d'autre, une truie apparaît dans le champ de vision, là où ne devrait apparaître personne. Comme si ceux qui souffraient de jet-lag gagnaient un degré de liberté supplémentaire, une mobilité qui leur permettait de s’échanger les uns contre les autres. Il semble que le centre de gravité soit décalé, le cœur bat plus fort, mais pas dans la poitrine : tout l'espace palpite. Sensation angoissante de frôler la trame de la réalité, comme un poisson qui glisse entre les mailles du filet, un fugitif qui échappe au réseau de caméras, un porc qui passe un pied dans le caillebotis. Des milliers d'yeux semblaient braqués sur moi, comme si les animaux pris dans le filet espéraient tous ensemble que l'un d'entre eux s'en sortirait.
J'étais nu et j'étais seul.
D'abord le sentiment d'être relié à des vies inconnues me réchauffa le cœur. Et aussitôt vint la certitude que j'allais faire du mal à quelqu'un que je ne connaissais pas encore. Que ce mal, à défaut d'être fait, était déjà tissé, comme mon corps à la vie entière » (pp. 175-176).
Son regard impitoyable sur la condition humaine reflétée dans la condition animale fait que tout retour en arrière, pour regagner l'ignorance et revenir à la vie ordinaire, s'avère impossible pour Martin Enders. Il finira par porter le fardeau de la lucidité et, dans sa chair, les stigmates de cette expérience : pour son gain d'humanité, il subit une perte corporelle (un sacrifice de plus), devenant boiteux suite à un accident dans l'élevage. (« Le boiteux » était aussi le nom du seul porcelet survivant de la portée que Marina avait tuée. Le jeu des miroirs et d'identifications multiples ne cesse de nous surprendre.) Il écrit son récit, on l'apprend à la fin, en attendant un enfant.
L'indicible vérité
Les nuances de la stupeur et du malaise, le décalage infiltré entre des consciences jadis apparentées, l'effondrement des certitudes et l'air invraisemblable dont le monde, vu d'une porcherie, s’imprègne sont brillamment restitués par Isabelle Sorente. Mais le plus remarquable, dans son roman, c'est qu'il advient également un hymne étrange et douloureux à la vie pas encore conçue, pas encore née, mais déjà morte : un paradoxe et une performance d'ordre non pas philosophique, mais littéraire – l'un des bénéfices secondaires d'un sujet fort traité par un écrivain plein de finesse.
Puisque la brutale prise de conscience de Martin Enders détermine une remise en cause intégrale, happant – comme dans tout roman qui porte bien son nom – la raison, le langage même et ses fonctions : ce qu'il vit et ce qu'il éprouve, le philosophe atterri dans la porcherie, tient par excellence de l'indicible lourd, de l'incommunicable, des vérités faites pour être vécues en solitaire. Ainsi, tout son récit se nourrit de la décomposition : processus propre à la viande au premier abord, dirait-on, mais que l'on découvre contaminant aussi le verbe et l'affect. Parler, c'est trahir. Le contenu des mots simples change jusqu'à l’incompréhension parmi les siens. Comment survivre, quand on devient le vecteur d'une vérité indicible ? Comment garder la raison au milieu d'une poussière rappelant les particules de vie amenées au monde pour se faire tuer à la chaîne ? Comment se résigner à enfanter, quand procréer signifie perpétuer la souffrance du monde souffrant ? A l'aide de quelles ruses revenir dans la société des humains quand on s'y sent irrévocablement étranger ?
Dans une chronique automnale, le roman d'Isabelle Sorente a été vu comme « la claque de la rentrée ». Je confirme : j'ai lu ce livre époustouflant avec un vif intérêt, en me réjouissant que le sujet de la condition animale soit traité sous l'angle de la fiction avec une telle maîtrise, et l'expérience de son protagoniste a résonné, pour moi aussi, comme une bonne gifle. Mais je savais que c'est incontournable : ouvrir les yeux sur les élevages et les abattoirs ne peut être qu'une plongée dans une lucidité inévitablement inconfortable. Et ce n'est peut-être pas par hasard : « s'il entre dans la lucidité tant d'ambiguïté et de trouble, c'est qu'elle est le résultat du mauvais usage que nous avons fait de nos veilles » (Emil M. Cioran).
Victoria Luta